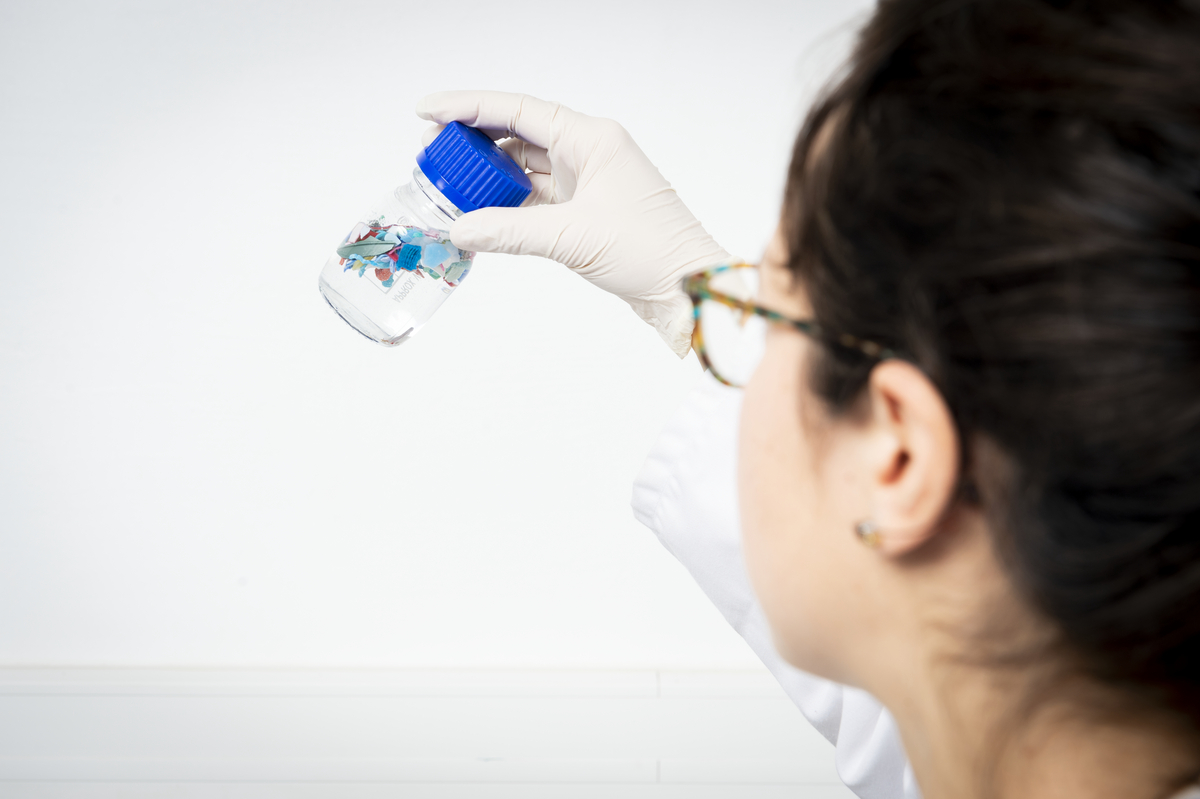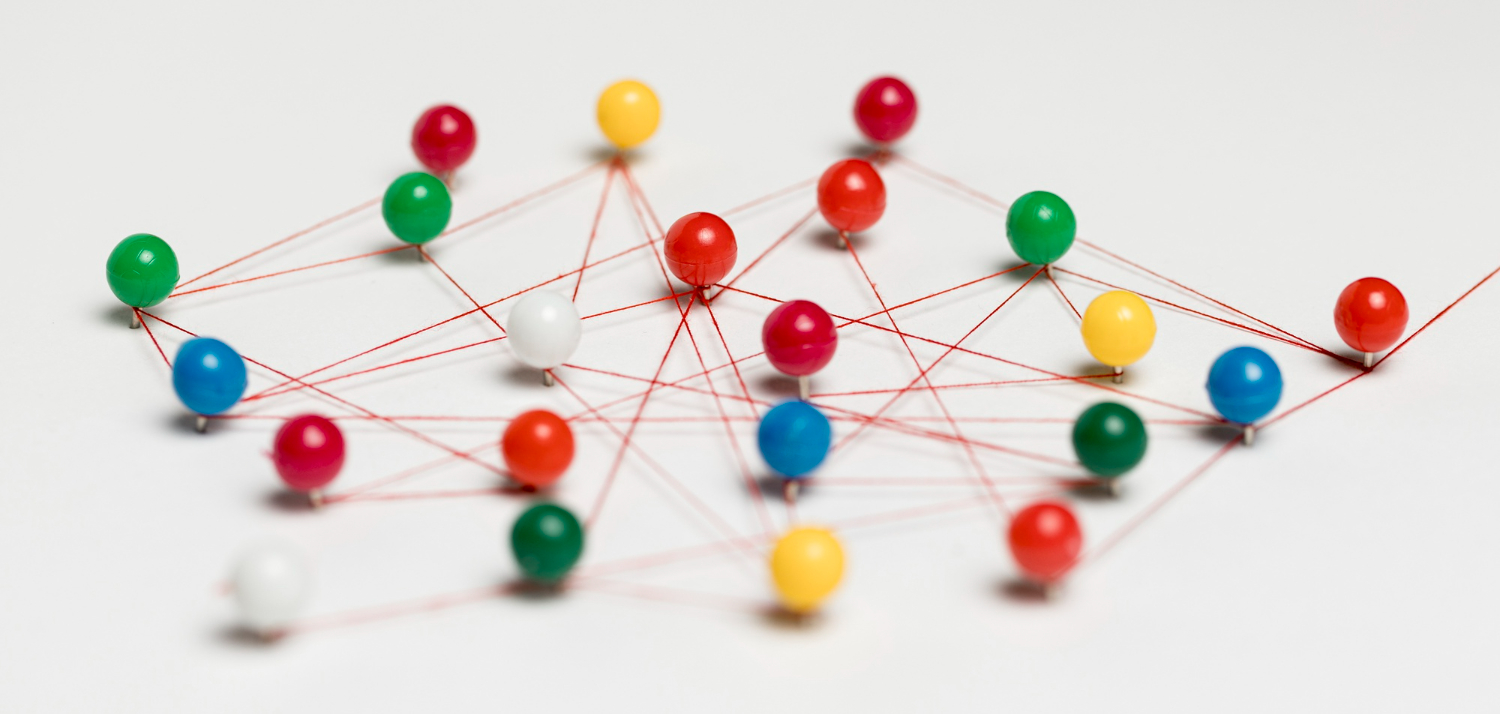
Quand la géographie
rencontre la chimie
Doctorante à Le Mans Université, Jeanne Perez étudie les flux plastiques en France pour analyser l’impact environnemental et sociétal de leur fin de vie. Cette thèse en interdisciplinarité se situe à la croisée de la géographie et de la chimie de l’environnement. Ses résultats viendront alimenter les recherches de l’axe Plastiques du PEPR, tant sur des travaux relevant de la chimie que ceux en sciences humaines et sociales (SHS).
Par Etienne Morisseau
Dès la création de l’axe Plastiques, Mathieu Durand, professeur en urbanisme à l’université du Mans propose d’incorporer les travaux de Jeanne Perez dans la tâche 1 du projet, qui se focalise sur les contaminants. Son étude, « Plastique en fin d’usage, matériaux et territoires : affiner les sous-catégories pour mieux les gérer », pourra ainsi apporter des éléments de contexte essentiels aux autres tâches du projet, en sciences dures comme en SHS.
Financé par la MITI (Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires) du CNRS, ce travail de recherche évolue aux interfaces de la géographie sociale, de la rudologie (l’étude des déchets) et de la chimie de l’environnement. Pour la mener à bien, Jeanne Perez a réalisé ses travaux entre le laboratoire Espaces et Société (ESO) et l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM). De cette manière, elle a pu observer et comprendre les plastiques sous plusieurs facettes : à la fois leur composition physico-chimique, qui permet de comprendre leurs conséquences sur l’environnement et la société, mais aussi leur aspect social, en étudiant les dynamiques entre les acteurs qui composent la filière et leur influence sur le flux. Tout cela permettant de porter une réflexion plus large sur la structuration des filières de recyclage des plastiques et le bouclage de ces flux.

« Je ne peux pas travailler sur la fin de vie des plastiques, sans comprendre leur début de vie », explique Jeanne Perez. Géographe de formation, la jeune chercheuse a dû apprendre les bases de la chimie des matériaux pour pouvoir travailler de concert avec des chimistes. C’est grâce à une combinaison entre lectures, cours du soir et interactions avec ses collègues de l’IMMM, qu’elle a ainsi pu entrer dans le monde de la chimie. « Je n’irai jamais faire des analyses en laboratoire. Je ne suis pas experte, mais je comprends les enjeux principaux », mesure-telle. De son côté, elle apporte également une vision SHS aux recherches du laboratoire : un vocabulaire technique, une connaissance du système, de ses acteurs, des réglementations…
Ça demande de l’énergie, de l’engagement, une véritable volonté des équipes de faire de l’interdisciplinarité. Si on ne veut pas s’ouvrir, ce n’est pas possible.
Bien entendu, la recherche interdisciplinaire n’est pas sans défis. « Ça demande de l’énergie, de l’engagement, une véritable volonté des équipes de faire de l’interdisciplinarité. Si on ne veut pas s’ouvrir, ce n’est pas possible », estime Jeanne Perez. D’après la chercheuse, un des points importants d’attention est la communication. Il est essentiel de bien définir les sujets et de trouver des points de convergence pour réussir à avancer ensemble. « Mais ça permet aussi de s’entraîner à expliquer notre discipline, nos méthodes de recherche », nuance-t-elle en observant l’aspect enrichissant de cette pratique. « Ça m’a fait prendre conscience qu’on fait le même métier, même si notre méthodologie est différente. On a une question de départ et une production de résultats ; on se comprend sur la manière de faire de la recherche. »
Cette mutualisation des connaissances a eu un impact au-delà des travaux de Jeanne Perez. Une collaboration qui passait au départ par le vecteur de la doctorante, a fini par créer des liens entre les deux laboratoires, qui se traduisent par la création de projets de recherche et d’actions de communication conjointes.
Selon Jeanne Perez, le contexte actuel autour du plastique amène de plus en plus à l’interdisciplinarité. Depuis 2020, la France a mis en place des réglementations sur l’économie circulaire des plastiques, une volonté politique qui pousse ce sujet originellement des SHS vers les sciences dures. Un élan qui permettra peut-être d’expérimenter de manière plus récurrente cette pratique, qui ouvre des perspectives nouvelles sur les travaux de recherche. La doctorante, qui souhaite continuer ses recherches par un post-doc au sein du PEPR Recyclage, conclue :
Ça vaut le coup de prendre du temps pour s’acculturer à de nouvelles disciplines et explorer des notions transverses ; mon étude ne serait pas aussi complète s’il n’y avait pas eu cette interdisciplinarité.
Plus d'actualités